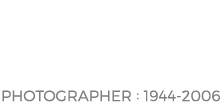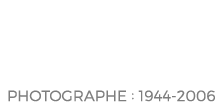De 1966 à 1968, Catherine Leroy est la seule photographe à couvrir le conflit du Vietnam en tant que correspondante de guerre. L’américaine Dickey Chapelle qui l’avait précédée sur le terrain avait été tuée en novembre 1965 par l’explosion d’une mine.
Les guerres américaines du Sud-Est asiatique donnèrent naissance à une nouvelle génération de grands photographes de combat, notamment : David Douglas Duncan en Corée; Eddie Adams, David Burnett, Larry Burrows, Gilles Caron, Henri Huet, Philip Jones Griffith, Don McCullin, John Olson, Tim Page, Kyoichi Sawada et Christian Simonpietri au Vietnam. Un univers éminemment masculin, souvent très sexiste.
Après la seconde guerre mondiale, les quelques rares femmes photographes de conflit étaient militaires, à l’exception notable de Margaret Bourke White de Life qui, dans les années 1950, couvrit la guerre de Corée, “embarquée“ avec les troupes sud coréennes, et de Dickey Chapelle, toute première photographe américaine correspondante de guerre morte sur le terrain lors d’un conflit armé. Avec le Vietnam, on trouve un peu plus de femmes chez les journalistes : Michèle Ray, Gloria Emerson, Kate Webb. Les femmes photographes apparaissent vraiment à partir de 1969 : les anglo-saxonnes Barbara Gluck-Treaster, Nancy Moran, Sarah Errington ; les françaises Christine Spengler, Françoise Demulder, Marie-Laure de Decker.
La bataille de Hué, janvier/février 1968
Seule photographe femme sur le terrain depuis près de deux ans, Catherine Leroy a 23 ans lorsque l’offensive du Têt éclate dans la nuit du 30 au 31 janvier 1968.
Cette vaste opération surprise lancée par les forces nord-Vietnamiennes pendant les fêtes de la nouvelle année lunaire, consiste en une série d’offensives armées contre plus d’une centaine de villes du sud-Vietnam. A Hué, ancienne cité impériale de 150.000 habitants, la bataille qui va durer près d’un mois, prend un tour symbolique et restera comme l’une des plus longues et sanglantes de la guerre. Les troupes de l’armée régulière sud-vietnamienne et de l’armée américaine finissent par la gagner, maison par maison, au prix de lourdes pertes humaines. La ville, détruite à 80%, est jonchée de cadavres. Echec militaire nord-vietnamien, l’offensive du Têt est cependant considérée par tous les historiens comme une victoire politique du nord et un tournant du conflit. Elle va en effet se révéler désastreuse pour le gouvernement américain qui doit faire face à des opinions publiques intérieure et internationale révulsées par cette guerre qui n’en finit pas.
Sur place, Catherine Leroy opère d’abord avec le journaliste français François Mazure avec lequel elle sera brièvement retenue prisonnière par des soldats nord-Vietnamiens dans les tous premiers jours de l’offensive. Elle en ramène un “scoop” qui fait la couverture du numéro de Life du 16 février 1968 et qui ajoute à sa notoriété acquise l’année précédente. Alors que ses collègues la croient en train de se reposer sur ses lauriers, elle retourne à Hué à la mi-février où elle travaille, en couleur, pendant une semaine, intégrée au sein d’une unité de Marines décimée et démoralisée qui livre un combat farouche et dérisoire. Certaines de ses photographies sont publiées sur dix pages dans le magazine Look du 14 mai 1968. Le choix éditorial de cette influente publication constitue une nette prise de position contre la guerre et en dit long sur la perception américaine de l’intervention au Vietnam.
L’été de son retour en France, Leroy décroche une commande, la couverture d’un festival pop au milieu des champs dans l’Etat de New York. La réadaptation à la vie quotidienne se révèle difficile pour elle et il est probable qu’elle commence à souffrir d’un syndrome post-traumatique. Elle se retrouve soudain propulsée parmi une foule de jeunes gens de son âge, prêts à profiter de tout, musique, amour et plus, pour assister à l’événement le plus emblématique de la contre-culture américaine des années 1960, le festival de Woodstock.
Des rotations d’hélicoptères survolent la gigantesque marée humaine pour déposer les groupes qui vont se produire sur scène. Tout en décompressant pour la première fois depuis son retour, Leroy fait tout de même son travail et immortalise Joan Baez, Carlos Santana, Janis Joplin, Ravi Shankar et autres invités prestigieux. Et surtout elle rencontre dans le public des gens qu’elle connaît bien, des vétérans, anciens du Vietnam. Chevelus et barbus, ils ne ressemblent plus du tout aux soldats armés et casqués qu’elle a côtoyés pendant trois ans. Ils sont mobilisés contre la guerre et bien décidés à le faire savoir. En 1972, elle les accompagnera dans leur convoi protestataire vers la Floride où la Convention du Parti républicain doit entériner la candidature de Richard Nixon pour un second mandat présidentiel. Une équipée relatée dans le film Operation Last Patrol.
Chute / Libération de Saigon, avril 1975
En avril 1975, Catherine Leroy retourne à Saigon alors que les forces nord-vietnamiennes et celles du Front National de Libération du Sud Vietnam approchent de la capitale du régime sud-vietnamien et que la chute de la ville est imminente. Elle couvre la fuite des civils, l’enterrement des derniers morts de la guerre, l’exfiltration des fonctionnaires américains le 29 avril, l’arrivée des premiers chars avec leurs soldats très jeunes et souriants qui se mêlent à la population dans un climat détendu. Le général Minh, dernier chef d’Etat du gouvernement soutenu par Washington se rend le 30 avril, quand le palais présidentiel est envahi par les troupes adverses. Le 8 mai, c’est le général Tran Van Tra qui incarne le nouveau régime et qui donne une conférence de presse. Les journalistes étrangers, contraints de rester dans le pays, assisteront à la parade des vainqueurs le 15 mai dans un climat de liesse avant d’être autorisés à repartir. C’est la fin de la guerre.
Guerre civile à Beyrouth, Liban 1975/82
En 1975, Catherine Leroy s’installe à Beyrouth avec son compagnon Bernard Estrade, correspondant permanent de l’Afp. Elle va couvrir la guerre civile de Beyrouth en 1976 et en 1982, tout en courant le monde, la plupart du temps sur des points chauds, multipliant les sujets les plus divers, comme beaucoup de confrères de sa génération. En Afrique, Somalie, Libye, Kenya, Gabon ; en Asie, Afghanistan, Pakistan, Japon et Chine; et au Moyen-Orient, Egypte, Gaza, Irak, Iran (où elle suit la révolution et le retour de l’Ayatollah Ruhollah Khomeiny en 1979), Jordanie et surtout Liban,
En juin 1982, Israël qui veut en finir avec l’Olp (Organisation de libération de la Palestine) de Yasser Arafat, lance l’opération “Paix en Galilée“ qui mène l’armée israélienne du sud Liban jusqu’à Beyrouth qu’elle assiège sous une pluie de bombes, causant d’énormes dommages et pertes parmi les civils, documentés notamment par Leroy, free-lance pour Time et son confrère le journaliste australien de Newsweek Tony Clifton. L’année suivante, ils décident d’en faire un livre à charge, “God Cried“, pour dénoncer l’opération et en montrer les effets, un ouvrage qui provoquera une très forte controverse.
L’ensemble des photographies de la période Liban de Catherine Leroy est en cours de répertoriation et de numérisation. Les images de Beyrouth prises en 1975 et 1976 présentées ici, font partie du travail qui lui a valu d’être la première femme à recevoir la prestigieuse médaille d’or Robert Capa décernée en 1976 par l’Overseas Press Club of America (OPC).
Dix ans de “troubles“, Irlande du Nord, août 1979
En août 1979, Catherine Leroy est à Belfast. C’est le dixième anniversaire des émeutes d’Irlande du Nord, qui avaient éclaté lors des parades annuelles des protestants orangistes. Depuis le début de l’année 1979 les attentats se multiplient. Le 27 août Lord Mountbatten, cousin de la reine Elisabeth, qui passe depuis trente ans ses étés en Irlande, meurt dans l’explosion d’une bombe posée par l’Ira (Armée républicaine irlandaise) sur son bateau de pêche. Le même jour, dix-huit soldats britanniques sont tués dans une embuscade de l’Ira à Warrenpoint dans le comté de Down.
Dix ans auparavant, en août 1969, la bataille du Bogside à Derry avait symbolisé le début des affrontements. Néanmoins c’est à Belfast qu’ils avaient été les plus durs et les plus violents, au point que pour la première fois le gouvernement britannique avait dû envoyer un renfort de l’armée à la mi-août pour tenter de rétablir l’ordre et maintenir la paix entre quartiers catholiques et protestants.
Le Vietnam réunifié et en paix, cinq ans plus tard, 1980
A l’automne 1980, cinq ans après avoir couvert la chute et la libération de Saigon à la fin avril et en mai 1975, Catherine Leroy retourne au Vietnam. Bernard Estrade, son compagnon de l’époque, dirige alors le bureau de l’Afp à Hanoï, la capitale. Avec lui, elle parcourt pendant plusieurs semaines un pays enfin en paix et découvre avec curiosité Hanoi, Ha Long et Haiphong et redécouvre Con Thien, Danang, Vung Tau ainsi que Saigon devenu Ho Chi Minh Ville après la réunification du nord et du sud qui a suivi la déroute politique et militaire des Etats-Unis. Son objectif saisit un quotidien tranquille, mais montre aussi les mutilés, tant combattants que civils, les vestiges de douze ans de guerre et s’attarde sur les enfants amérasiens, ces filles et fils de Vietnamiennes et de soldats américains repartis dans leur pays, surnommés avec mépris “les enfants de poussière“.